À lire : un extrait de “Crack capitalism” de John Holloway
Rompre
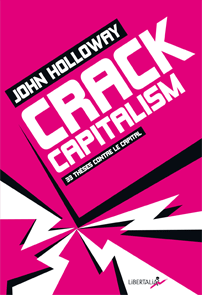 1. Rompre. Nous voulons rompre. Nous voulons créer un monde nouveau. Maintenant. Rien de plus banal, rien de plus évident. Rien de plus simple. Rien de plus difficile.
1. Rompre. Nous voulons rompre. Nous voulons créer un monde nouveau. Maintenant. Rien de plus banal, rien de plus évident. Rien de plus simple. Rien de plus difficile.
Rompre. Nous voulons rompre. Nous voulons briser le monde tel qu’il est. Un monde d’injustices, de guerres, de violences, de discriminations, de Gaza et de Guantánamo. Un monde de milliardaires dans lequel un milliard de gens vivent et meurent de faim. Un monde où l’humanité s’annihile elle-même, massacre les formes non humaines de vie et détruit les conditions de sa propre existence. Un monde gouverné par l’argent, gouverné par le capital. Un monde de frustrations et de gaspillage des possibilités.
Nous voulons créer un monde nouveau. Nous protestons ; bien sûr, nous protestons. Nous protestons contre la guerre, contre l’utilisation croissante de la torture dans le monde ; nous protestons contre la transformation de toute forme de vie en marchandise à vendre et à acheter, nous protestons contre le traitement inhumain des immigrés, nous protestons contre la destruction du monde dans l’intérêt des profits.
Nous protestons et nous faisons davantage. Nous le faisons et nous devons le faire. Si nous protestons seulement, nous permettons aux puissants de mettre en avant leur ordre du jour. Si tout ce que nous faisons consiste à s’opposer à ce qu’ils essaient de faire, alors nous ne faisons simplement que suivre leurs pas. Rompre signifie que nous faisons davantage que cela, que nous prenons l’initiative et que nous fixons l’ordre du jour. Nous nions et, au travers de notre négation, se développe une création, un autre-faire, une activité qui n’est pas déterminée par l’argent, une activité qui n’est pas façonnée par les règles du pouvoir. Souvent le faire alternatif émerge de la nécessité : le fonctionnement du marché capitaliste ne nous permet pas de survivre et nous avons besoin de trouver une autre façon de vivre, des formes de solidarité et de coopération. Souvent, elle découle également d’un choix : nous refusons de soumettre nos vies à l’empire de l’argent, nous nous consacrons à ce que nous considérons comme nécessaire et désirable. D’une façon ou d’une autre, nous vivons dans le monde que nous voulons créer.
Maintenant. Il y a urgence. Assez ! Ya basta ! Nous en avons assez de vivre dans un monde d’exploitation, de violence et de famine et nous en avons assez de créer un tel monde. Maintenant il y a une nouvelle urgence, l’urgence du temps lui-même. Il est devenu clair que nous, les humains, nous sommes en train de détruire les conditions naturelles de notre propre existence ; et il semble improbable qu’une société dans laquelle la force déterminante est la recherche du profit puisse renverser cette tendance. Les dimensions temporelles de la pensée radicale et révolutionnaire ont changé. Nous plaçons un crâne sur nos bureaux, comme les moines de l’ancien temps, non pas pour glorifier la mort, mais pour nous concentrer sur le danger imminent et pour intensifier la lutte pour la vie. Cela n’a plus aucun sens de parler de la patience comme une vertu révolutionnaire ou de parler d’une « future révolution ». Quelle future révolution ? Nous avons besoin d’une révolution maintenant, ici et maintenant. Si absurde, si nécessaire. Si évidente.
Rien de plus banal, rien de plus évident. Il n’y a rien de spécial dans le fait d’être un révolutionnaire anticapitaliste. C’est l’histoire de beaucoup, beaucoup de gens, de millions, peut-être de milliards de gens.
C’est l’histoire du compositeur à Londres qui exprime sa colère et son rêve d’une meilleure société à travers la musique qu’il compose. C’est l’histoire du jardinier à Cholula qui crée un parc pour lutter contre la destruction de la nature. Celle de l’ouvrier de l’automobile à Birmingham qui se rend le soir à son jardin ouvrier afin d’avoir une activité ayant un sens et lui procurant du plaisir. Celle des paysans indigènes à Oventic au Chiapas qui créent un espace autonome d’autogouvernement et qui se défendent tous les jours contre les paramilitaires qui les harcèlent. L’histoire du professeur d’université à Athènes qui organise un séminaire en dehors du cadre universitaire pour promouvoir la pensée critique. Celle de l’éditeur de Barcelone qui concentre son activité sur la publication de livres contre le capitalisme. Celle d’amis à Porto Alegre qui forment une chorale, seulement parce qu’ils prennent plaisir à chanter ensemble. Celle d’enseignants à Puebla qui affrontent l’oppression policière pour lutter pour une école de type différent, pour un type différent d’éducation. Celle d’une metteuse en scène de théâtre à Vienne qui décide qu’elle utilisera ses compétences pour ouvrir à un autre monde les gens qui viennent voir ses pièces. Celle de ce travailleur d’un centre d’appels à Sydney qui occupe tout son temps libre à réfléchir à la façon de lutter pour une meilleure société. C’est l’histoire des gens de Cochabamba qui se sont rassemblés pour mener ensemble une bataille contre le gouvernement et l’armée afin que l’eau ne soit pas privatisée mais soumise à leur propre contrôle. Celle de l’infirmière de Séoul qui fait tout son possible pour aider ses patients. Celle des ouvriers de Neuquén qui occupent leur usine et la font marcher pour leur propre compte. Celle de l’étudiant de New York qui décide que l’université est un temps pour questionner le monde. Celle du travailleur communautaire de Dalkeith cherchant les failles dans le cadre des règles contraignantes qu’il subit pour pouvoir s’ouvrir à un autre monde. Celle de ce jeune homme à Mexico qui, exaspéré par la brutalité du capitalisme, part dans la jungle organiser une lutte armée pour changer le monde. Celle de l’enseignante retraitée de Berlin qui consacre sa vie au combat contre la mondialisation capitaliste. Celle de la fonctionnaire à Nairobi qui donne tout son temps libre à la lutte contre le sida. Celle de l’enseignant universitaire à Leeds qui utilise l’espace qui existe encore dans certaines universités pour mettre en place un cours sur l’activisme et le changement social. Celle du vieil homme, vivant dans un horrible ensemble d’immeubles en banlieue de Beyrouth, qui cultive des plantes sur le rebord de sa fenêtre comme une révolte contre tout le béton qui l’entoure. Celle de la jeune femme à Ljubljana, celle du jeune homme à Florence, qui, comme tant d’autres à travers le monde, s’attellent dans leurs vies à inventer de nouvelles formes de lutte pour un monde meilleur. C’est l’histoire du paysan de Huejotzingo qui refuse de permettre que son petit verger soit annexé à un grand parc de voitures invendues. Celle du groupe d’amis sans abri à Rome qui occupe une maison non habitée et refuse de payer un loyer. Celle d’un enthousiaste de Buenos Aires qui investit son énergie débordante à ouvrir des perspectives en vue d’un monde différent. Celle de la jeune fille de Tokyo qui dit qu’elle n’ira pas au travail aujourd’hui et va s’asseoir dans un parc pour lire son livre, ce livre ou un autre. Celle du jeune homme en France qui se consacre à construire des toilettes sèches pour contribuer à un changement radical dans les relations entre les hommes et la nature. Celle de l’ingénieur en téléphonie à Jalapa qui quitte son job pour pouvoir passer plus de temps avec ses enfants. Celle de la femme d’Édimbourg qui, dans tout ce qu’elle fait, exprime sa rage à travers la création d’un monde d’amour et de solidarité mutuelle.
C’est l’histoire de gens ordinaires, certains que je connais, certains dont j’ai entendu parler, certains que j’ai inventés. Des gens ordinaires : des rebelles, peut-être des révolutionnaires. « Nous sommes des femmes et des hommes tout à fait ordinaires, des enfants et des personnes âgées, c’est-à-dire des rebelles, des non-conformistes, des inadaptés, des rêveurs », disent les zapatistes dans leur défi le plus profond et le plus difficile qu’il soit1.
Les « gens ordinaires » dans notre liste sont très différents les uns des autres. Il peut sembler étrange d’y mettre l’ouvrier de l’automobile qui se rend à son bout de jardin le soir à côté du jeune homme qui part dans la jungle pour consacrer sa vie à organiser la lutte armée contre le capitalisme. Pourtant il y a une continuité. Ce que l’un et l’autre ont en commun, c’est qu’ils participent à un mouvement à la fois de refus et de création : ils sont des rebelles et non des victimes ; ils sont des sujets, pas des objets. Dans le cas du travailleur de l’automobile, c’est une démarche individuelle, seulement les soirs et les week-ends. Dans le cas du jeune homme dans la jungle, il s’agit d’un engagement très périlleux, le choix d’une vie de rébellion. Ce sont des démarches très différentes, mais avec un trait commun qu’il serait complètement faux de nier.
Rien de plus simple. Le théoricien français du xvie siècle, La Boétie, a exprimé avec une grande clarté le caractère très simple de la révolution dans son Discours de la servitude volontaire (1546) :
« Vous semez vos champs afin qu’il [le seigneur] puisse les dévaster ; vous meublez et remplissez vos maisons afin de fournir à ses pilleries ; vous élevez vos filles afin qu’il puisse assouvir sa luxure ; vous nourrissez vos enfants, afin que, dans le mieux qu’il leur saurait faire, il les mène en ses guerres, qu’il les conduise à la boucherie, qu’il les fasse ministres de ses convoitises, et les exécuteurs de ses vengeances ; vous rompez à la peine vos personnes afin qu’il puisse mignarder en ses délices et se vautrer dans les sales et vilains plaisirs ; vous vous affaiblissez afin de le rendre plus fort, et qu’il vous tienne plus rudement la bride plus courte. Et de tant d’indignités que les bêtes elles-mêmes ne les sentiraient pas ou ne les supporteraient pas, vous pouvez vous en délivrer, si vous l’essayez, non pas de vous en délivrer, mais seulement de vouloir le faire. Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libres. Je ne veux pas que vous le poussiez ou l’ébranliez, mais seulement ne le soutenez plus, et vous le verrez, comme un grand colosse à qui on a dérobé sa base, de son poids même s’effondrer en bas et se rompre. »
Considérant tout ce que le tyran nous a pris et a tiré de notre exploitation, nous n’avons plus qu’à cesser de travailler pour lui et il cessera d’être un tyran, puisque les bases matérielles de sa tyrannie disparaîtront. Nous fabriquons le tyran ; pour être libres, nous devons cesser de le fabriquer. La clef de notre émancipation, la clef pour devenir pleinement humain est simple : refuser, désobéir. Décidez de ne plus jamais servir, et aussitôt vous êtes libérés.
Rien de plus difficile, cependant. Nous pouvons refuser de réaliser le travail qui crée le tyran. Nous pouvons nous consacrer à une activité d’un type différent. Au lieu de « rompre à la peine nos personnes afin qu’il puisse mignarder en ses délices et se vautrer dans les sales et vilains plaisirs », nous pouvons faire quelque chose que nous considérons comme important et désirable. Rien de plus banal, rien de plus évident. Et, cependant, nous savons que ce n’est pas si simple. Si nous ne consacrons pas nos vies au travail qui crée le capital, nous sommes confrontés à la pauvreté, et même à la misère, et souvent à la répression physique. De là où j’écris, juste en bas de la route, les gens de Oaxaca ont pris le contrôle de leur ville pendant cinq mois, contre un gouverneur corrompu et brutal. Finalement, leur rébellion pacifique a été réprimée par la violence et beaucoup de gens ont été torturés, maltraités sexuellement, menacés d’être abattus depuis des hélicoptères, leurs doigts ont été brisés, certains ont tout simplement disparu. Pour moi, Oaxaca se trouve juste en bas de la route. Mais pour vous, aimable lecteur, ce n’est pas beaucoup plus loin, et il existe beaucoup d’autres endroits « juste en bas de la route » où des atrocités sont commises en votre nom. Abu Ghraib, Guantánamo – et il y en a bien d’autres, beaucoup d’autres que l’on pourrait citer.
Souvent cela semble sans espoir. Tant de révolutions ont échoué. Tant d’expériences anticapitalistes passionnantes se sont terminées en frustrations et en récriminations. Quelqu’un a écrit qu’« aujourd’hui il est plus facile d’imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme » (Turbulence, 2008). Nous avons atteint un stade où il est plus facile de penser à la destruction totale de l’humanité que d’imaginer un changement dans l’organisation d’une société manifestement injuste et destructrice. Que pouvons-nous faire ?
- 1. « Somos mujeres y hombres, niños y ancianos bastante comunes, es decir, rebeldes, inconformes, incómodos, soñadores » (La Jornada, 4 août 1999).
Holloway, Crack capitalism. 33 thèses contre le capital, Traduction de José Chatroussat, Paris, Libertalia, 464 pages.
